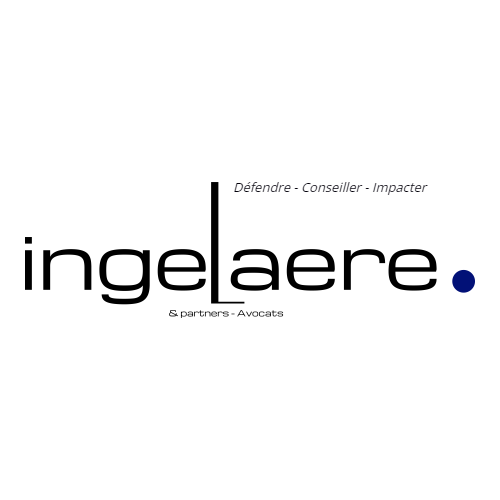Définition légale du harcèlement moral dans la fonction publique
L’élément central de cette définition est la répétition des faits et leurs conséquences sur l’agent victime.
Cette approche légale est dans la continuité des textes qui protégeaient antérieurement les fonctionnaires, notamment l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais abrogé au profit du CGFP. Les comportements concernés par la définition doivent, soit viser, soit produire effectivement une altération substantielle des conditions de travail.
Régime disciplinaire applicable aux auteurs de harcèlement moral
Sanction disciplinaire : fondement et principe d’autonomie du droit disciplinaire
L’auteur d’agissements de harcèlement moral dans la fonction publique commet une faute disciplinaire exposant à une sanction. Il s’agit d’un principe fondamental réaffirmé expressément par les textes du CGFP, qui précisent que tout agent ayant procédé à des faits constitutifs de harcèlement moral, ou en ayant donné l’ordre, est passible d’une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, la procédure disciplinaire est totalement autonome de la procédure pénale. L’administration est en droit, et souvent tenue, de diligenter une procédure disciplinaire indépendamment de la saisine et des suites de la juridiction pénale.
Ainsi, la relaxe pénale n’interdit pas la sanction disciplinaire si la matérialité des faits est avérée sur la base d’une appréciation différente de la preuve (exemple : faits non constitutifs du délit mais suffisants pour caractériser une faute disciplinaire).
Échelle des sanctions disciplinaires
L’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires est fixée par l’article L533-1 du CGFP, qui répartit les sanctions en quatre groupes, par ordre croissant de gravité :
| Groupe | Sanction(s) envisageable(s) |
|---|---|
| Premier groupe | Avertissement, blâme, exclusion temporaire (maximum 3 jours) |
| Deuxième groupe | Radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion 4 à 15 j, déplacement d’office |
| Troisième groupe | Rétrogradation, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans |
| Quatrième groupe | Mise à la retraite d’office, révocation |
Le choix de la sanction appartient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui doit toujours veiller à la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits commis.
Exemples chiffrés de sanctions :
- Blâme ou avertissement : Peuvent être envisagés dans l’hypothèse où les faits sont jugés isolés ou d’une gravité moindre (même s'ils relèvent de la définition du harcèlement moral, la sanction pourra être adaptée à la mesure exacte de la faute, selon l’appréciation de l’administration).
- Exclusion temporaire de fonctions : Fréquemment prononcée lorsque les faits sont avérés comme constituant du harcèlement moral caractérisé, sans préjudice d’autres mesures protectrices pour la victime, pouvant aller jusqu'à une exclusion de plusieurs semaines, ou de plusieurs mois si l’infraction est grave et répétée.
- Déplacement, rétrogradation, révocation : En cas de pluralité de faits ou de gravité nette (démarche concertée de mise à l’écart, pressions continues conduisant à des arrêts maladies prolongés, démonstration d’une volonté manifeste de nuire), des sanctions du 3e ou 4e groupe, extrêmement lourdes, sont juridiquement possibles et parfois prononcées.
Exemples concrets tirés de la jurisprudence administrative récente
La sanction disciplinaire pour harcèlement moral a fait l’objet de décisions importantes :
- Le Conseil d’État exerce un contrôle normal de la qualification des faits et de la proportionnalité de la sanction. Ainsi, il n’hésite pas à reconnaître la gravité du harcèlement pour justifier des sanctions allant jusqu’à la mise à la retraite d’office ou la révocation (CE, 13/11/2013, n° 347704).
- La Cour administrative d’appel de Paris a ainsi reconnu en 2025 un harcèlement moral caractérisé sur une période de 5 ans, justifiant l’octroi d’une indemnisation importante à la victime, la titularisation de la qualification juridique étant un préalable à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire contre l’agent fautif.
- Il arrive que des changements d’affectation injustifiés, des sanctions disciplinaires injustifiées à l’encontre de la victime, un isolement systématique, des brimades répétées, constituent le faisceau d’indices suffisant pour démontrer la matérialité des faits de harcèlement moral.
Procédure applicable
La sanction disciplinaire, pour être valable, doit respecter le contradictoire et, pour les sanctions les plus graves (au-delà du premier groupe), être précédée d’une saisine obligatoire du conseil de discipline.
Le dossier doit être motivé. Les sanctions du premier groupe (avertissement, blâme, exclusion temporaire ≤ 3j) sont effacées du dossier si aucune nouvelle sanction n’est prononcée dans un délai de trois ans.
Articulation de la sanction disciplinaire avec les mesures civiles et pénales
Articulation avec les poursuites pénales
Le harcèlement moral est aussi un délit pénal, puni d’une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (Code pénal, art. 222-33-2). La prescription de l’action publique court à compter du dernier acte de harcèlement.
Dans l’hypothèse où un agent public est poursuivi devant la juridiction pénale et reconnu coupable, la sanction disciplinaire peut être aggravée, mais la relaxe pénale ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire si la matérialité des faits, de nature déontologique ou statutaire, a été établie à suffisance. Cela s’explique par la distinction entre le degré de preuve requis pénalement (principe de légalité stricte et présomption d’innocence) et la spécificité de l’office du juge disciplinaire.
Articulation avec les mesures d’ordre civil et indemnitaire
L’administration peut être condamnée à indemniser la victime de harcèlement moral, soit à l’initiative d’une action de la victime devant la juridiction administrative pour réparation des conséquences du harcèlement moral, soit lors d’une action pour défaut de protection fonctionnelle.
La juridiction pénale peut aussi accorder des dommages et intérêts à la victime à l’issue de la procédure pénale, à condition que le préjudice subi soit caractérisé et en lien direct avec les agissements.
Exemples de cumul
- Un agent reconnu coupable de harcèlement moral peut, pour les mêmes faits, faire l’objet d’une sanction disciplinaire (par exemple, exclusion temporaire ou révocation), d’une condamnation pénale (emprisonnement, amende), et d’une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la victime.
- En cas de dommage subi par un tiers à la suite du harcèlement, l’administration peut aussi exercer une action récursoire contre l’agent auteur des faits, en particulier si elle a été condamnée à réparer le préjudice au titre de la responsabilité extracontractuelle.
Droits de la défense et règles procédurales spécifiques
L’agent poursuivi disciplinèrement bénéficie de l’ensemble des protections procédurales du CGFP : information sur la nature des faits reprochés, accès au dossier, audition, assistance par un défenseur, notification de la sanction motivée. En cas de sanction du deuxième groupe ou plus, la consultation préalable du conseil de discipline est impérative.
Les faits doivent être précisément qualifiés et motivés. Le principe de proportionnalité doit être strictement respecté, le juge exerçant un contrôle plein sur l’adéquation de la sanction à la gravité des faits. Toute sanction disproportionnée encourt l’annulation par le juge administratif pour erreur manifeste d’appréciation.
Il est également rappelé qu’aucune mesure, même de type disciplinaire, ne peut être prise contre un agent ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de faits de harcèlement moral.
Sanctions complémentaires et mesures protectrices
Outre la sanction disciplinaire, l’administration peut être amenée à prendre des mesures complémentaires, telles que l’éloignement temporaire de l’agent harceleur, la suspension de fonctions à titre conservatoire pendant la durée de l’enquête, ou des mesures de protection au bénéfice de la victime.
De plus, la loi impose désormais aux administrations de disposer d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, facilitant la remontée d’information, la protection des victimes et la célérité de la réaction administrative.
Typologie des comportements sanctionnés
La variété des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral est grande : isolement professionnel, critique systématique, retrait abusif de responsabilités, surcharge délibérée ou inversement déni de travail, transmission délibérée de consignes floues ou contradictoires, humiliation en public, mutation injustifiée, sanctions disciplinaires répétées et injustifiées, etc.
Exemples récents de jurisprudence administrative :
- Isolement d’un agent par suppression de sa participation aux réunions, retrait injustifié d’organigrammes, privation prolongée d’outils de travail, refus de fourniture d'informations, etc. : sanction décidée dans plusieurs décisions récentes rendues par la CAA de Paris ou la CAA de Marseille.
- Répétition de mesures préjudiciables à l'agent sur plusieurs années, dans le but délibéré de précariser et nuire : condamnation de l’État et sanction disciplinaire aggravée prononcée contre l’auteur du harcèlement.
Protection des victimes et des témoins
Le CGFP consacre (article L133-3) la protection complète des agents ayant témoigné ou relaté de bonne foi les faits de harcèlement moral. L’administration a l’obligation d’assurer la protection fonctionnelle des victimes (prise en charge des frais, soutien juridique et psychologique), et de mettre en œuvre toute mesure de cessation du trouble.
Synthèse des sanctions applicables
| Auteur des faits | Sanction disciplinaire | Sanction pénale | Dommages et intérêts (civils) |
|---|---|---|---|
| Tout agent public | Jusqu’à la révocation ou mise à la retraite d’office (selon gravité) | Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende | Réparation du préjudice, selon la juridiction administrative ou judiciaire |
| Chef de service hiérarchique | Même échelle, avec plus grande sévérité en cas d’abus avéré | Idem | Idem, cumul possible |
| Agent contractuel | Rupture de contrat, éviction | Idem | Idem |
Conclusion
En définitive, le harcèlement moral, lorsqu’il est établi dans la fonction publique, expose son auteur à des sanctions disciplinaires pouvant aisément atteindre les degrés les plus sévères de l’échelle (jusqu’à la révocation, mise à la retraite d’office, voire cumuls avec des peines pénales et des amendes élevées), sans préjudice des mesures réparatrices au profit de la victime et de possibles sanctions complémentaires. La jurisprudence récente montre un durcissement de la politique administrative contre ces comportements et un alignement croissant, dans l’appréciation de la gravité, entre juge administratif et juge pénal. Le respect rigoureux de la procédure et des droits de la défense, ainsi que la proportionnalité des sanctions, restent des exigences contrôlées par le juge.

 Retrouvez les avis clients contrôlés
Retrouvez les avis clients contrôlés